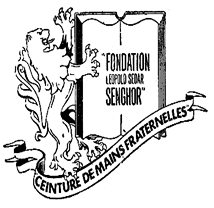NEGRITUDE ET AMERICANISME
Ethiopiques numéro 04
Revue socialiste
de culture négro-africaine
octobre 1975
Négritude et américanisme
ou let america be america
Ce texte est l’allocution prononcée le 27 mai 1975 par l’écrivain Léopold Sédar Senghor au dîner annuel du Pen Club des Ecrivains américains.
J’en suis conscient, si vous m’avez invité, à votre dîner d’aujourd’hui, comme hôte d’honneur, ce n’est pas en ma qualité d’homme politique, mais d’écrivain.
Pendant que je me demandais de quoi j’allais vous parler, je me suis rappelé mon premier entretien avec John F. Kennedy. Dès qu’il m’eut fait asseoir près de lui, il me demanda, abrupt mais souriant : « Qu’est-ce que la Négritude ? ». J’ai donc pensé qu’Américains, et écrivains au demeurant, vous vous intéresseriez à ce problème culturel plus qu’à un problème purement politique. D’autant qu’au Sénégal, dans notre politique de développement économique et social, l’éducation, l’information et la formation, d’un mot, la culture est la priorité des priorités.
J’ai donc intitulé cette allocution Négritude et Américanisme. En effet, il s’agira, ici, moins de l’ « « Américanité », c’est-à-dire l’ensemble objectif des valeurs de la civilisation américaine, que de l’ « Américanisme », au sens où le mot désigne une vision subjective du monde, mais pour l’action, en partant des valeurs de cette même civilisation.
Mais pourquoi confronter – plus exactement, faire dialoguer – la Négritude et l’Américanisme ? Parce que je suis aux Etats-Unis, mais aussi que, comme l’écrivait Hermann von Keyserling, dans la préface à l’édition française de Diagnostic de l’Amérique et de l’Américanisme, « nous vivons, aujourd’hui, dans l’ère historique américaine ».
L’Amérique, vous le savez, malgré les accidents de parcours qui lui arrivent de temps en temps – mais c’est la vie -, vient en tête de tous les pays du monde, qu’il s’agisse de la production brute, du revenu par tête d’habitant, des découvertes scientifiques et de leurs applications techniques, etc. L’Amérique préfigure donc notre avenir, nous montre la voie dans laquelle, nolentes volentes, nous nous engagerons. Le problème est de savoir si cet avenir sera un avenir de vie ou de mort, qui dépend des Américains. Quelle terrible responsabilité ! Cependant, devant cette responsabilité, qui est vôtre, nous ne pouvons rester muets : il nous faut engager le dialogue avec vous. Nous partagerons, nécessairement, votre responsabilité du fait que nous sommes des hommes.
C’est un ami de l’Amérique qui vous parle. Cependant, si j’admire votre grand peuple, c’est moins pour ses exploits scientifiques et techniques, moins pour ses potentialités physiques que pour ses possibilités humaines : pour l’épanouissement culturel qu’elle peut réaliser aux dimensions de l’Universel. Pour quoi j’ai donné comme sous-titre à mon propos : Let America be America.
La Négritude
Il est temps de vous définir la Négritude. Je le ferai, d’abord, à l’africaine en partant du réel – j’allais dire des « faits ». Je l’ai souvent raconté, c’était au collège-séminaire Libermann, à Dakar. Me destinant à la prêtrise, je m’entrainais à la discipline de l’obéissance : à dompter mon caractère, naturellement rebelle, par le jeûne, la confession et les exercices spirituels. Cependant, quand il s’agissait du problème national, plus exactement de ma dignité d’homme noir, alors je ne pouvais plus me soumettre.
Contrairement à ce que disait le Père-Directeur, je sentais que nous n’étions pas des « sauvages », c’est-à-dire des hommes sans culture, sans Œuvres de bonté, de beauté, de vérité. Je me rappelais le roi du Sine, Koumba Ndofène Diouf, qui venait, en grand arroi, rendre visite à mon père, maître de terres, maître de troupeaux, mais, par-dessus tout, maître de traditions. Des griots, à cheval, entouraient le Roi et, frappant, rythmiques, leurs tam-tams d’aisselle, ils chantaient. Et depuis, je n’ai jamais entendu chants si beaux. Je me rappelle les cadeaux qu’échangeaient les hôtes, et surtout leurs paroles, qui étaient des œuvres d’art : des œuvres de sens et de beauté, fondées qu’elles étaient sur les principes de la téranga et de la kersa, de l’« honneur » et de la « mesure ». Sous ces deux mots, il y a, je ne voudrais pas dire le « système », mais toute la structure qui sous-tend la civilisation du peuple sérère, dont je suis issu : un des peuples de la région soudano-sahélienne.
La Négritude, ce sont toutes ces choses dont j’avais l’intuition sans pouvoir encore les définir exactement. C’est d’une part, une somme de qualités – de « valeurs », comme on dit aujourd’hui – qui caractérisent la civilisation des Noirs, comme le sens de la communion et celui du rythme ; c’est, d’autre part, la façon dont chaque Noir vit ou entend vivre ces valeurs. Ces deux aspects, objectif et subjectif, de la Négritude correspondent à l’Américanité et à l’Américanisme.
Américanité Américanisme
Je reviens à l’Amérique et aux Américains. Ce qui frappe, dans votre pays, ce sont ses dimensions de troisième pays du monde, le nombre de sa population et ses contrastes aussi bien ethniques que physiques. Mais, d’abord, ces derniers : le froid sec de l’Alaska, par-delà la parenthèse canadienne, et la chaleur moite du Sud ; l’Océan atlantique, qui vous rattache à l’Afrique comme à l’Europe, et le Pacifique, qui, au-delà des Iles, vous lie à l’innombrable Asie.
Ces dimensions et le peuplement de l’Amérique à partir des trois continents du vieux monde laissent deviner sa diversité ethnique. Cependant, la nature et l’histoire, voire la préhistoire, ont forgé à l’Amérique – et elle s’est forgé – une personnalité culturelle qui, pour être plus plastique, n’est pas moins caractéristique que celle des autres grandes nations, qui ont noms Russie, Chine, France, Egypte, etc.
Mais quelle est-elle, cette personnalité culturelle collective, cette Américanité ? C’est ce que je voudrais dire avant d’en dégager l’idéologie : l’Américanisme, qui est projet d’être.
René Descartes, qui est plus actuel qu’on ne le croit généralement, distinguait, dans la raison, trois facultés : le « penser », le « vouloir » et le « sentir ». Eh bien, du fait du peuplement moderne à majorité anglo-saxonne et protestante, en tout cas indo-européenne, du fait aussi que les premiers immigrés, les « Pionniers », furent immédiatement aux prises avec une nature dure dans ses contrastes, de tous ces faits, les Américains ont surtout cultivé le penser et le vouloir aux dépens du sentir. Je veux dire une raison discursive, une pensée qui analyse et distingue, qui range et compte, une pensée technicienne parce que tournée vers la nature, mais pour la dominer, toute tournée vers la matière à maîtriser et posséder pour, non la connaître, mais l’utiliser. Nous verrons, tout à l’heure, pourquoi.
Rien d’étonnant, dès lors, que, depuis la fin du XIXe siècle, les Etats-Unis d’Amérique aient apporté une contribution décisive au développement de la pensée humaine, singulièrement dans les sciences. L’Annuaire statistique de l’UNESCO nous indique qu’en 1972, les Etats-Unis ont fourni 15 % des publications parues dans le monde et 6 % de celles traitant des sciences, pures ou appliquées, alors que leur population représentait seulement 5,5%SSS de la population du globe. Mais plus significatif est le pourcentage des prix Nobel. Plus caractéristique, sur un total de 298 prix décernés en Physique, Chimie, Physiologie et Médecine, de 1901 à 1974, 101 sont revenus à des Américains, c’est-à-dire plus du tiers.
A cause de cette puissance, de cette prépondérance scientifique et du dynamisme avec lequel les Américains passent de la théorie à la pratique, de l’invention à la création et du savant au consommateur, on a vite fait de crier au « matérialisme ». Le problème n’est pas simple. Si matérialisme signifie mépris de l’intelligence, alors l’accusation tombe à côté. Sous la plume d’un Keyserling, le matérialisme signifie que l’intelligence américaine s’attache aux faits plus qu’à leurs sens, à leurs qualités concrètes, mesurables, exploitables, standardisations et non à leurs vertus sensuelles, vitales, qui leur donnent, comme images analogiques, toute leur spiritualité.
Spiritualité américaine
Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de spiritualité américaine. Celle-ci est même typique et vigoureuse. Elle l’était, du moins, au temps des pionniers. C’étaient des protestants, c’est-à-dire des chrétiens qu’animait l’esprit de libre examen. C’étaient, en même temps, des puritains : des chrétiens qui entendaient revenir à la pureté du christianisme primitif.
Je le sais, ceci contredit cela, car les premiers chrétiens vivaient, dans le pathos, pour parler comme Keyserling, une foi du cœur, tandis que les Américains réalisent, dans l’ethos, c’est-à-dire dans une morale élaborée, une croyance raisonnée. Mais la contradiction n’existe que dans un premier temps, celui précisément des Pionniers, ou ceux-ci vivaient leur foi dans l’ardeur de la conquête, physique et morale. Assez vite, prévalut le vrai esprit protestant et anglo-saxon, scientifique et pragmatique – ici, il n’y a pas contradiction -, où l’on identifia la loi morale au travail, à l’argent, enfin, à la science.
C’est cette réalité ethnique et sociale qui a informé la spiritualité américaine. Spiritualité s’il en fut parce qu’essentiellement polarisée vers le bien, mais détournée par l’intellect : hier, par la règle, l’équerre et le compas, aujourd’hui, par l’ordinateur. Je dis : détournée et comme déracinée de la terre, de la chair, parce qu’on a banni des réalités de notre monde, et d’abord de l’homme, le tempérament et la différence, la spontanéité et l’émotion, bref, la sensualité.
Encore une fois, il s’agit d’une spiritualité élevée. Si l’on considère, par exemple, le catholicisme dans le Nouveau Monde, l’on constatera facilement qu’il est plus pur, parce que moins superstitieux, aux Etats-Unis, ou non seulement la prêtrise, mais la vie contemplative compte plus d’adeptes, pour le même nombre de catholiques, qu’en Amérique latine. Et cette spiritualité est active. Contrairement à beaucoup d’anticolonialistes ou d’anti-impérialistes, je crois, par exemple, à la générosité du peuple américain. Nous venons de l’éprouver encore à l’occasion de la sécheresse qui a, pendant un cycle de huit ans, sévi en Afrique soudano-sahélienne. Ce que l’on peut mettre en question, c’est l’objet de sa générosité, singulièrement les intentions de ses hommes politiques, comme dans les péripéties de la guerre froide, mais pas la nature de sa générosité.
La guerre froide, ai-je dit, et vous vous souvenez d’Hiroshima, et vous songez à la prochaine guerre, qu’on nous annonce nucléaire, à la troisième Guerre mondiale, que je vous prédis raciale si l’on n’entend pas le Message. Cependant, ne soyons pas distraits, je ne vous parle pas politique, mais encore culture. « La menace qui pèse sur l’homme », dit Martin Heidegger dans La Question de la Technique, « ne provient pas, en premier lieu, des machines et appareils de la technique, dont l’action peut éventuellement être mortelle. La menace véritable a déjà atteint l’homme dans son être. Le règne de l’Arraisonnement nous menace de l’éventualité qu’à l’homme puisse être refusé de revenir à un dévoilement plus originel et d’entendre, ainsi, l’appel d’une vérité initiale ». J’ai souligné les mots essentiels : arraisonnement et dévoilement. J’y reviendrai.
Nous voici jetés au cœur même du problème de la Négritude et de l’Américanisme. Je vais essayer, dans une deuxième partie, d’en démêler les éléments pour voir si l’on ne pourrait, en manière de conclusion, proposer l’esquisse d’un accord conciliant. Mais il me faut, auparavant, essayer de définir, en quelques mots, l’idéologie américaine : l’Américanisme.
Dans cette première partie, j’ai voulu dégager les éléments les plus importants de l’étant américain ou américanité, qui se caractérise essentiellement par la domination tyrannique de la raison discursive, du « penser », qui aboutit à privilégier la science et la technique. Ce facteur est à la base de la révolution technologique du XXe siècle, qui constitue l’un des progrès majeurs réalisés par les hommes depuis quelque 5.500.000 ans qu’ils existent, et qu’ils pensent. _ L’Américanisme, c’est le « vouloir », je précise : le projet qui entend se servir de la technologie, c’est-à-dire de la science du savoir-faire, pour faire de l’homme un animal pensant, voire sur-pensant, mais dont le but essentiel sera de fabriquer son bien-être en satisfaisant, par priorité, bien sûr, mais surtout d’une façon privilégiée, ses « besoins animaux » : la nourriture, le logement, les transports, les loisirs, d’un mot, le « niveau » et non pas la « qualité » de vie. En effet, lorsqu’on parle de « qualité de vie », il est surtout question de la lutte contre les pollutions matérielles ; et même lorsqu’il s’agit de loisirs, on pense à la consommation plus qu’à la production des biens matériels, à l’enseignement plus qu’à l’éducation : au bien-être plus qu’au plus-être.
Culture – Négritude Américanisme
Ce qui m’amène à la deuxième partie de mon propos : à la Culture, dont la Négritude n’est qu’un aspect.
Malgré l’Américanisme, il y a la possibilité d’une culture américaine digne de cette expression, qui serait exemplaire parce que la plus grande du monde. Non qu’elle serait nécessairement la plus scientifique, la plus technologique, la plus grande productrice de biens matériels, mais simplement la plus humaine parce que la plus intégrale.
Or j’ai l’impression que l’Amérique ne veut pas profiter de la conjoncture pour saisir sa chance ; qu’elle tourne le dos à celle-ci. Dans la confrontation – j’aurais voulu employer un autre mot – qui, depuis 1973, oppose le monde développé au monde en développement, elle semble n’avoir pas vu que le problème rassortissait fondamentalement à l’ethos, et qu’il fallait, pour le résoudre, des solutions plus culturelles qu’économiques. Plus précisément, une attitude culturelle était une condition préalable. J’entends par « attitude culturelle » celle-là qui consiste à penser que les deux groupes d’Etats sont à égalité morale, qu’ils ont des besoins, comme des richesses, complémentaires dans les deux domaines économique et spirituel. Au lieu de cela, placée à la tête des pays développés, armée de ses ordinateurs, pour ne pas parler des autres armes, l’Amérique nous parle « énergie » et « prix ». Encore une fois, je ne parle pas politique, je parle culture.
Mais qu’est-ce que la Culture ? C’est cette énergie spirituelle qui réalise l’accord de l’homme et de lui-même, de ses pensées et de ses instincts comme de ses sentiments, de son esprit et de sa chair, l’accord de l’homme avec les autres hommes, mais surtout des hommes avec la nature et, par-delà, avec Dieu. La culture, c’est la tension de notre étant transitoire vers un plus-être à réaliser, où l’accord conciliant que voilà s’étendrait progressivement à tous les domaines du « penser », du « vouloir », du « sentir », et il s’approfondirait en accord plus harmonieux parce que plus ajusté.
C’est le sens des trois phrases de Heidegger. M’éclairant des deux sens que le mot peut avoir en français, je dirai que « l’Arraisonnement », c’est l’arrachement et la stérilisation, par la raison discursive, des éléments fertilisants, de l’homme et, partant, de la culture, je veux dire les sentiments et les instincts qui baignent dans les sens, comme les racines dans l’humus et l’humidité de la terre-mère. C’est pourquoi le philosophe nous invite à « revenir à un dévoilement plus originel ». En effet, comme l’avaient déjà vu les anciens Grecs, la vérité, a-lètheïa, c’est le « dé-voilement », à nos yeux, des réalités primordiales que sont les sentiments et les instincts, qui, parce que baignant dans la sensualité, sont d’autant plus actifs dans la vie.
Ce qui nous ramène à la Négritude, mais aussi à la culture américaine, car il y a, déjà, une culture américaine, qu’illustrent, parmi d’autres, William Faulkner et T.S. Eliot, sur lesquels je reviendrai, pour ne m’en tenir qu’aux écrivains.
L’école française, depuis Maurice Delafosse, a insisté sur le côté apollinien de la culture noire tandis que l’école allemande le faisait du côté dionysiaque et que l’anglaise, comme l’américaine, s’attachait aux faits. C’est ainsi que le Français Dominique Zahan, dans un ouvrage au titre significatif – Religion, Spiritualité et Pensée africaines -, met l’accent sur le « penser » et le « vouloir » négro-africains. Il nous y montre le Nègre dans son effort pour élaborer une éthique et une mystique : le Nègre tout occupé à se maîtriser comme à se connaître par le silence et la méditation, l’ascèse et la pratique quotidienne de la sagesse.
Ce rééquilibrage était nécessaire encore qu’il traduise surtout le faciès soudano-sahélien de la culture noire, tel qu’il s’exprimait, à mes yeux, dans mon enfance sérère. Il reste que, si le Noir, comme toutes les ethnies, est doué, en sa qualité d’homme, des trois vertus de la raison humaine, il a surtout cultivé celle des profondeurs : se sentir qui colore, mais surtout rythme toutes ses activités, depuis son rire jusqu’à son chant et depuis le travail de ses paysans jusqu’aux œuvres de ses mathématiciens.
Arrêtons-nous seulement à l’art nègre : à ce style que nous retrouvons, le même, sur les cinq continents, dans toutes les œuvres des Noirs. C’est toujours la même communion, voire la même identification, avec l’Autre, exprimée par l’image et le rythme, à l’opposé du réalisme, quelle que soit l’épithète dont on affuble le mot.
Il s’agit d’une image charnelle avec son volume et son poids, sa forme et sa couleur, par-dessus tout, avec son mouvement sous la peau : d’une image simple et forte, qui porte son sens parce qu’elle unit, dans l’univers des signes, le visible et l’invisible, la nature et l’homme, l’homme et Dieu, les trois vertus de l’âme humaine dont nous parle Descartes, bref, le sensuel et le spirituel. Il s’agit d’un rythme qui n’est pas répétition, mais résurgence, véritablement résurrection par la parole Résurgence donc avec une nouvelle nuance sinon un nouveau sens, en tout cas, une nouvelle force, qui brisera, par l’asymétrie, la monotonie de la répétition : par le swing, je veux dire la vigueur du coup de poing de la vie, triomphant de la mort.
Mais qu’est-ce, au juste, que se sentir – ou cette sensualité – à quoi je prête la vertu la plus substantielle et qui explique le style nègre ? Pour le Négro-Africain, c’est une force vitale, que les Bambaras du Mali désignent sous le nom de nyama. Dominique Zahan le définit comme « un mouvement vibratoire, principe commun à tous les êtres, identique, non sans quelques différences de degré, dans la matière inorganique et dans les êtres vivants ». C’est ce que Pierre Teilhard de Chardin appelle l’« énergie ». Pour le savant et philosophe français, l’étoffe de l’univers, ce n’est pas la matière, mais « l’Esprit-Matière ». Cette étoffe est composée de deux faces, dont l’une est matière et l’autre esprit. Plus précisément, ce que nous considérons comme de la matière morte est animé, en réalité, par une énergie, c’est-à-dire une force qui, à ce niveau, est « un fourmillement de consciences élémentaires ». Je vous renvoie à son ouvrage posthume intitulé l’Energie humaine.
Les Négro-Africains n’avaient pas dit autre chose. Dans la perception du monde extérieur, quels qu’en soient les éléments, c’est cette énergie latente de la matière que touche et perçoit notre énergie humaine à travers nos sens, qui fonctionnent comme des centres de conscience élémentaire. Dans un corps – un caillou, un arbre, un cheval, un homme -, le savant ou le technologue ne s’intéresse qu’au côté extérieur, matériel, à ce qui est mesurable et standardisable, tandis que ce à quoi s’attache l’homme s’abandonnant à son énergie humaine, c’est au spontané, à l’imprévisible, au différent : pas à la quantité, mais à la qualité. A travers les formes et les couleurs, les sons et les odeurs, les mouvements et les contacts du monde visible, c’est à se sentir que s’attache la sensualité noire, qui, en définitive, est d’ordre spirituel. La preuve en est que, dans l’acte d’amour, comme le rapporte Geneviève Calame-Griaule dans Ethnologie et Langage, la tendresse de la parole de l’homme est l’élément le plus fécondant. En effet, saisie et, de ce fait, voyant les formes de l’intérieur, la sensualité les interprète en leur donnant un sens humain. Par ce sens même, elle les crée comme le Créateur : le Poète. Pour quoi je dis que la sensualité, la sensualitas, qui signifia d’abord « sensibilité », est raison intuitive, mieux, énergie spirituelle, tandis que l’érotisme des pays développés, c’est la sensualité « arraisonnée » par l’intellect : une sensualité aseptisée, débarrassée de tout germe fécondant, et morte.
L’universum
Je reviens, de nouveau, à l’Américanisme pour m’acheminer vers ma conclusion.
Le « vouloir » américain est légitime, et que votre puissant peuple veuille se hausser à l’imposer au monde, comme « culture universelle », c’est ce qui fait une partie de sa grandeur, mais une partie seulement. En effet, et j’ai essayé de le montrer, le projet américain, sous l’influence de la raison discursive, du développement des sciences et des techniques, a laissé glisser et se perdre l’autre raison, qui était son fondement, je dis la vertu nocturne des profondeurs : le « sentir ». Une culture universelle qui n’engloberait pas l’universum, ne serait pas culture, mais un cancer qui aurait gagné toutes les nations. L’universum, le « projet » américain doit en rassembler les éléments et les éprouver avant de chercher à l’imposer à toutes les nations.
Il faut donc rassembler les éléments de l’universum en cette Amérique qui est le microcosme du monde : avec les cousins germains – c’est le cas de le dire – à côté des Anglo-Saxons, très précisément les Scandinaves, Néerlandais et Allemands ; avec surtout ces ethnies plus éloignées qui ont apporté les pollens fécondants de leur Einfühlung, pour parler comme les Allemands, c’est-à-dire les Slaves et les Latins. Je n’oublierai pas les Juifs ni les Celtes des îles britanniques, mais, si je mentionne, pour mémoire, les Jaunes et les Indiens, j’insisterai sur les Noirs, qui, parce que les plus éloignés dans l’espace mais pas dans le temps, sont les plus enrichissants.
Cependant, comme je l’ai dit plus haut, il y a, déjà, une culture américaine authentique de l’Universel, et c’est ce qui autorise l’espoir. Le jazz et sa danse en témoignent et la musique moderne, qui prolonge la blanche, mais animée par le jazz. En témoignent également, avec les meilleurs des écrivains négro-américains que vous savez, les grands écrivains blancs, en tête desquels je placerai William Faulkner et T.S. Eliot. Non pas seulement parce qu’ils ont obtenu le prix Nobel, mais que je les ai personnellement lus, sentis et mâchés en les expliquant. Qu’on ne me demande pas si ces deux écrivains ont été pour les droits civiques et l’intégration. Ils ont fait mieux : ils ont coupé le nœud gordien en intégrant, l’un et l’autre – Faulkner directement, Eliot par affinités -, l’essence du style nègre.
Relisez donc William Faulkner en analysant sa phrase avec ses images analogiques, qui éclairent notre quête dans la nuit du sens, avec ses résurgences, ses mots-signaux qui ne se répètent pas, avec ses contretemps et syncopes. C’est la démarche lente mais sûre, la parole, assimilée, d’un paysan noir du Sud, voire de l’Afrique. Je vous renvoie au roman du Camerounais Ferdinand Oyono, intitulé Le vieux Nègre et la Médaille.
La référence à T.S. Eliot vous aura surpris davantage. Ce n’est que l’apparence d’un paradoxe. Avec sa vaste culture classique – latin et grec, italien et français -, l’écrivain, au premier abord, semble être à l’opposé de la Négritude. Cependant, s’il m’a d’abord charmé, envoûté, c’est qu’il y a, entre le Southerner d’origine celtique et le Négro-Africain, des affinités enracinées dans les mêmes abîmes du sentir. Une certaine familiarité avec le poète m’a vite révélé, à travers les images symboliques de sa mythologie moderne, « une manière nouvelle », comme l’écrit C. M. Bowra, « que ses répétitions et son rythme heurté et obsédant rendent presque liturgique ».
Ce n’est pas hasard si, pour caractériser les styles de T.S. Eliot, la critique emploie les mêmes mots qui définissent le jazz et, d’une façon générale, l’art nègre. Pas hasard si les deux génies américains que voilà sont des hommes du Sud profond, et qu’ils expriment si intégralement l’Homo-Americanus de l’avenir : cet homme symbiose des trois raisons, de toutes les ethnies qui habitent l’Amérique, qui travaillent en Amérique, qui travaillent, informent, modèlent l’Amérique, pour, encore une fois, de son étant, transitoire parce que dispersé, faire un être intégral à la dimension de la planète humaine. C’est ce que voulait dire Langston Hughes, mon ami regretté, quand il chantait :
Let America be America again
Let America be the dream the dreamers dreamed
0, let America be America again
The land that never has been yet
And yet must be [1]
Au fond, les jeunes écrivains négro-américains des années 60-70, singulièrement les poètes, comme Don Lee, Lance Jeffers, Sonia Sanchez et Nikki Giovanni ne disent pas autre chose sous leurs formes agressives. S’ils visent essentiellement à découvrir et exprimer leur identité négro-africaine, ils ne la présentent pas moins comme un des faciès du « monde entier ». Ils ne refusent pas l’intégration culturelle, puisque c’est d’elle qu’il s’agit ; ils refusent de venir les mains vides au banquet de l’Universel. Car il y a, sous eux, derrière eux, avec eux les richesses de l’ « Afrique prodigieuse ». Je parle, avec Don Lee, des richesses spirituelles :
In this world
We face our comings as hip slaves
unknown to ourselves
Unknown to the actual challenges
of the race.
Do you know your real name ?
Do you know the real reasons you are here ? [2]
Oui, les Noirs sont ici pour témoigner et pour créer : pour aider, eux aussi, à faire une Amérique plus américaine parce que plus humaine. Personne ne l’a fait mieux que Langston Hughes, le plus nègre et, en même temps, le plus américain des poètes négro-américains. Et le plus universel :
I, too, I am America.
I am the darker brother.
I, too, sing America. [3]
[1] Que l’Amérique soit l’Amérique de nouveau
Que l’Amérique soit le rêve dont rêvèrent les rêveurs
O, que l’Amérique soit l’Amerique de nouveau la terre qui n’a jamais encore été
Et cependant doit être.
[2] Dans ce monde
Nous affrontons notre lot, esclaves frelatés du siècle, étrangers à nous-mêmes
Etrangers aux véritables défis de la race.
Connais-tu ton vrai nom ?
Sais-tu les vraies raisons de ta présence ici ?
[3] Moi aussi, je suis l’Amérique.
Je suis le frère noir.
Moi aussi, je chante l’Amérique.
-MYTHOLOGIE DU MASQUE AFRICAIN
-IMAGE DE LA FEMME NOIRE DANS LA LITTERATURE D’AMERIQUE LATINE
-PANGOLS, par Philippe Sène
-IBIS-ANUBIS
-POEMES DE L’AFRIQUE NOUVELLE : Si je cesse de danser
-POEMES DE L’AFRIQUE NOUVELLE : Les beaux temps modernes
-POEMES DE L’AFRIQUE NOUVELLE : Qui est tout ?
-POEMES DE L’AFRIQUE NOUVELLE : Noël